Portant sur 910 espèces de vertébrés suivies entre 1970 et 2022, le document révèle que 52 % de celles-ci, incluant des mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens, connaissent une baisse d’abondance. En moyenne, la tendance observée au cours de ces années montre un déclin médian de 10 % des populations.
Selon le Fonds mondial pour la nature, section Canada (WWF Canada), le Nunavut est identifié comme l’une des régions subissant de fortes pressions du développement industriel, minier et des infrastructures en plus de composer avec les effets des changements climatiques. Le rapport ne contient toutefois aucune donnée précise portant sur les populations d’espèces sur le territoire.
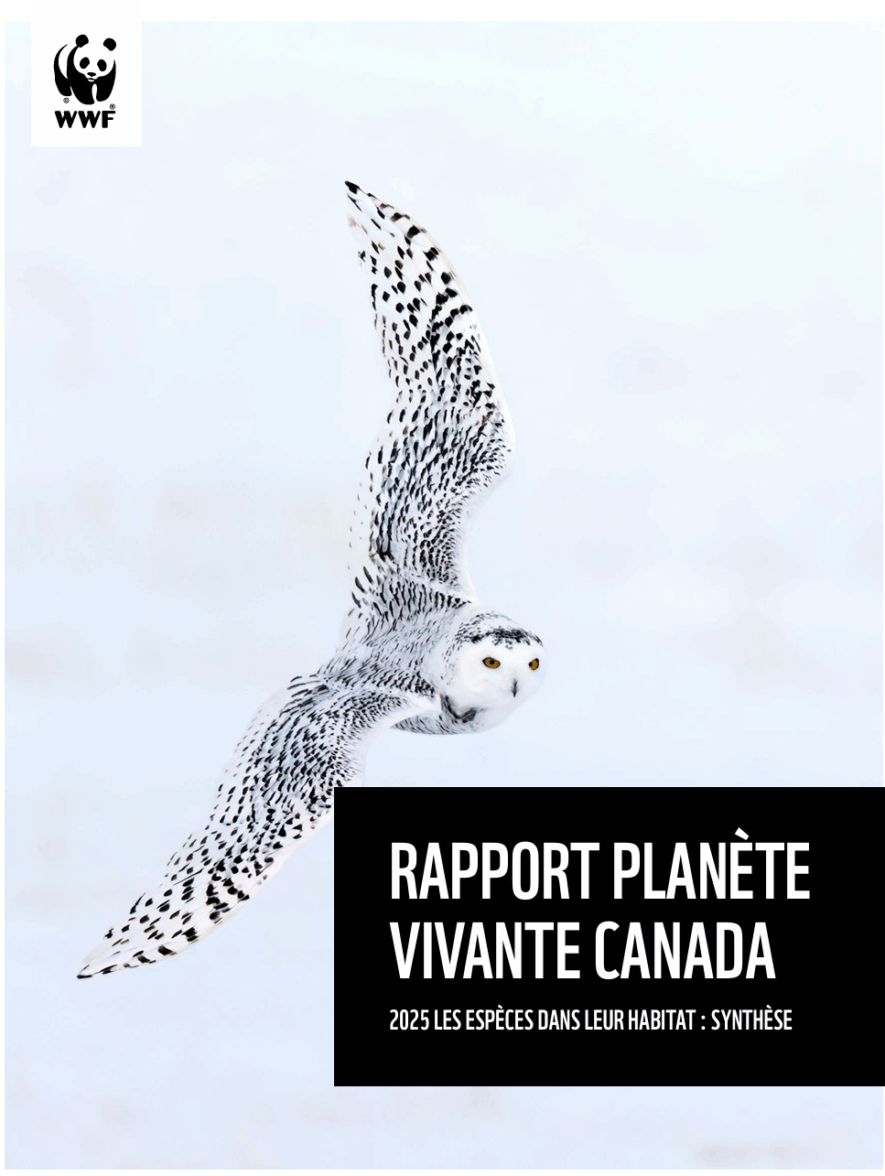
Selon Emily Giles (WWF Canada), l’île de Baffin aurait connu un déclin de 98% dans les populations de caribou.
Des troupeaux de caribous en péril
« Les conclusions du Rapport Planète vivante Canada sont le signal d’alarme de la nature. Elles nous disent que les espèces et ses habitats sont menacés. Cet avertissement est aussi l’occasion pour nous d’inverser le cours des choses avant qu’il ne soit trop tard. Il est impératif que nous agissions maintenant pour protéger et restaurer la nature qui soutient non seulement les espèces, mais aussi toutes les économies mondiales », affirme Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada.
Le RPVC 2025 est publié au moment même où les gouvernements de tout le pays privilégient la rapidité du développement en assouplissant les règlements qui protègent l’environnement et les espèces en péril.
« Dans la nature, tout est interconnecté. La dégradation d’un habitat ou la perte d’une seule espèce peut entrainer des répercussions en chaine. Une fois qu’une population est en déclin, la tendance devient difficile à renverser »
Bien que certains animaux, comme la loutre de mer ou les rapaces, montrent des signes de rétablissement, d’autres, telles que le caribou, la chauve-souris ou le harfang des neiges, continuent de reculer fortement partout au Canada. En moyenne, les populations suivies d’espèces des prairies ont décru de 62 % et celles des mammifères forestiers de 42 % au cours des cinq dernières décennies.
Questionnée en conférence de presse, Emily Giles, gestionnaire science, savoir et innovation de WWF-Canada explique qu’un déclin massif d’environ 98 % du caribou dans le troupeau de l’île de Baffin a été enregistré depuis 1991. Cette baisse est liée aux éléments industriels de la région ainsi qu’aux changements climatiques. « C’est vraiment préoccupant parce que les caribous sont des espèces très importantes pour beaucoup d’Inuit, tant dans la culture que comme source de nourriture », ajoute Mme Giles.
James Snider, vice-président, Science, savoir et innovation au WWF-Canada estime que le Canada a la responsabilité croissante d’intensifier ses efforts pour restaurer, protéger et gérer ce qu’il reste de la biodiversité.
Le 28 août dernier, les gouvernements du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest ont signé un protocole d’entente pour la gestion et la protection des caribous qui a entre autres comme objectif de partager les données et l’information relative à l’état des hardes.
Contacté pour offrir des précisions notamment en lien avec les mesures qui semblent le mieux fonctionner pour freiner cette tendance, un expert en conservation arctique de WWF-Canada n’avait pas donné suite à notre requête au moment d’écrire ces lignes.
« Les peuples autochtones ont l’autorité de décider comment les données sur leurs terres et leurs eaux sont collectées, utilisées et partagées. Cette forme de souveraineté des données est essentielle pour des pratiques de conservation équitables et efficaces », peut-on lire dans le RPVC.
Valoriser les savoirs traditionnels
Interrogée sur cet aspect lors du dévoilement du rapport, Catherine Paquette de WWF-Canada indique que l’organisation collabore à des projets locaux réalisés au Nunavut tels que l’Initiative pour la biodiversité arctique, qui vise à soutenir les leaders inuit dans la conservation, la surveillance et la protection des habitats marins et de la glace, tout en tenant compte des besoins culturels, des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire.
Six autochtones ont participé à l’étude pour y inclure différentes perspectives et partager leurs connaissances et leurs expériences, dont Abel Aqqaq de la Taloyoak Umaruliririgut Association.
« Une des solutions pour contrer le déclin de la biodiversité au Canada doit être d’entrer en partenariat avec les groupes autochtones incluant les communautés inuit pour s’assurer que non seulement nous redressons ce déclin, mais que ces groupes voient également que leurs priorités sont mises de l’avant à l’échelle nationale », conclut Catherine Paquette.








